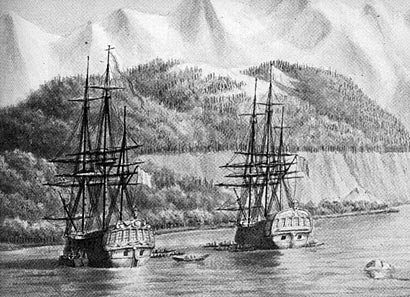Dans la nouvelle gare, des équipements sportifs financés par le CG :
Eric Ciotti, Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, introduit le débat en signalant notamment que le collège Vernier ne possède pas d’équipement sportif, et que le projet « gare du Sud » doit prévoir un gymnase répondant au besoin de Vernier. Le Conseil Général financera le projet dans ses aspects équipements sportifs. Cet investissement est évalué à 5 ou 6 millions d’euros.
Christian Estrosi, Député-Maire de la ville de Nice, précise que la ville de Nice est aux côtés du CG pour "sortir le quartier Libération de 28 ans de difficultés et de stagnation".
Estrosi : "un chantier au coeur de la valorisation du patrimoine niçois"
C’est une question de patrimoine dont on débat aujourd’hui. Le patrimoine niçois doit être préservé, exhumé, réhabilité.
On évoque le palais de la méditerranée, l’hôtel Rhul (à côté du casino de même nom), le palais de l’agriculture… La gare du Sud s’inscrit dans ce prolongement, aux cotés de l’abbaye de Roseland, la tour Payrolière, un couvent dans le vieux Nice. Ainsi l’histoire et la culture locale seront préservée.
...Après 28 ans de projets en l'air...
La municipalité Peyrat avait un autre projet, en proposant tout à tour une façade de verre, un velium, un déménagement de l'édifice.... La déstruction avait débuté et entamé une partie de la façade. Après l’appel de l’artiste Ultra-violet, Christian Estrosi était intervenu auprès du ministre de la culture (Lang ?)pour stopper la démolition, en classant la façade à l'inventaire du patrimoine des MH.
Aujourd’hui la construction d’une mairie de Nice serait impossible à cause du coût exorbitant.
On revoit le dossier avec moins d'ambitions et moins de moyens. Le nouveau projet prévoit de garder l’édifice originel et ainsi l’équilibre architectural du quartier.
Quelle nouvelle gare du Sud ?
"Cela fait 28 ans que le dernier train a quitté la gare, et depuis, les habitants se demandent quel sort est réservé au bâtiment".
Après 2 ans de polémiques, de lacunes juridiques, de débats d’autres politiques, Estrosi veut mettre un terme, en organisant une concertation publique.
Comment avec peu de moyen préserver ce patrimoine ?
Monsieur le Maire propose de réhabiliter la façade, et de reconstuire la gare originelle avec sa verrière (aujourd’hui démontée et stockée aux abattoirs).
La gare du Sud, ce Monument Historique :
Aussi, on rappel la valeur globale du batiment : la façade fut élaborée par G. Bobin, la façade par Effel. Ces éléments architecturaux sont uniques et précieux, il faut les conserver. Il est donc inutile de lancer des cabinets d’architectes sur des projets qui dénatureraient l'édifice.
La nouvelle gare du Sud d'Estrosi :
Elle serait inscrite dans un grand quartier marchand, avec la ligne 1 du tram. On espere ainsi :
- Valoriser l’identité et le patrimoine historique
- Développer un pole d’animation urbain
- Élargir l’offre de service et d’équipements de proximité.
"Aujourd’hui la place de la libération est vide, grisée par le mobilier du marché [...] Le centre de vie de la ville est limité au vieux Nice et à Massena".
Dans ce nouveau batiment, Estrosi veut une façade ouvrant sur une grande halle intérieur, toutefois sans remettre le marché extérieur en cause.
Ainsi on pense créer un pole attractif, vivant, un peu sur le modèle Lyonnais.
Un batiment qui change le centre de gravité urbain
C’est une question d’équilibre commercial, de place de stationnement (900 places), d’aménagement sportif, animation commerciale, de sécurité (police municipal mutualisé avec les nationaux, raccordement aux 300 caméras de vidéosurveillances qui seront prochainement installées).
Le train des pignes pourrait être aménagé en tram-train, avec une parfaite correspondance qui mènerait vers l’Ouest (parc impérial, madeleine, Lingostière…).
Au niveau des espaces verts, le jardin de la villa Thiole sera fermé par des grilles, réaménagé et agrandi.
Ces travaux sont évalués à 15 millions d’euro pour la collectivité, sur un projet globalement évalué à 35 millions d’euros. Il devrait être achevé en Novembre prochain.
Le planning d’aménagement d’espaces verts devrait être réalisé au 3ème trimestre 2013. Pendant ce temps des peintres et entreprises spécialisées réaliseront une toile devant la façade, qui embellira le bâtiment et son parvis durant les travaux.
Enfin, depuis 28 ans d’attente, un projet commun et collectif lance le quartier vers un nouveau projet.
Alain Philipe, Adjoint au Maire en charge de l'Urbanisme, précise en guise de conclusion que ce projet couvre plusieurs aspects (sociaux, éducatifs, culturels, sportifs, commerciaux, sécuritaires…).
Ce projet s’inscrit dans une perspective écologique puisqu’il propose une « coulée verte ».
De plus le programme prévoit un aspect de renforcement social, en dynamisant le quartier et en offrant aux niçois un nouveau pôle.
Durant les travaux on tente de limiter les nuisances visuelles, notamment avec un phasage des réalisations.
Les Questions :
- "L’avenue Borriglione-Massena : c'est une des plus belles avenues de Nice, alors que Jean Médecin est plus abandonnée. La gare est intégrée dans un cadre architectural vaste et sa réalisation est un chef d’œuvre. Les projets soumis jusque là sont ridicules".
On demande comment la liaison train-tram sera réalisée ; Est-ce que la verrière pourrait être équipée en photovoltaïque ; Est-ce que la place de la libé pourrait être colorée, sans cette grisaille et cette « toile d’araignée » ; peut on prévoir un tri sélectif avec les commerçants ?
Estrosi signal que le tri sélectif et le photovoltaïque sont étudiés. Au niveau de la liaison train-tram, un plan est prévu pour faire une voie au Sud du bâtiment de la gare.
L’esthétique et l’architecture du quartier seront étudiées.
- "L’encorbellement de la gare doit être conservé pour des questions de mobilités des handicapés. Un espace culturel manque actuellement, nous n’avons pas de salle de plus de 350 places à proximité".
Estrosi répond que les projets sont étudiés pour permettre un accès à tous dont les personnes à mobilité réduite, tout en conservant le parvis dans son aspect originel. L’encorbellement fait parti du bâtiment et de l’équilibre architectural, il sera conservé.
La construction de salles en multiplex est prévue dans une taille raisonnable et suivant l’offre locale de manière à ne pas tuer l’attraction des autres pôles.
- "Que faites-vous contre les faux handicapés ; et pour garantir une meilleur mobilité ?"
Estrosi : Ce chantier très lourd est en cours mais il prend du temps pour recenser et réaliser des aménagements. Une loi prévoit pour 2015 de meilleurs aménagements.
- "L’établissement d’un poste de police : le quartier est très sensible mais est ce que la sécurité sera renforcée ?…"
Estrosi : La délinquance est très présente alors nous allons développer la vidéosurveillance et utiliser des systèmes de géo-positionnement pour la stopper.
Patrick Mottard (opposant, Conseiller Général des Alpes-Maritimes) souligne des difficultés dans le projet :
- Les encorbellements signalés ici comme conservés semblent être modifiés dans les projets des architectes.
- Le marché serait présent à l’extérieur et dans la halle ; comment trouver tant d’exposants et comment meubler l'espace, hors marché ?
La concertation se termine avec d'autres questions générales.
Lectures annexes :